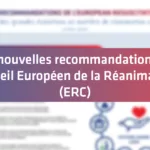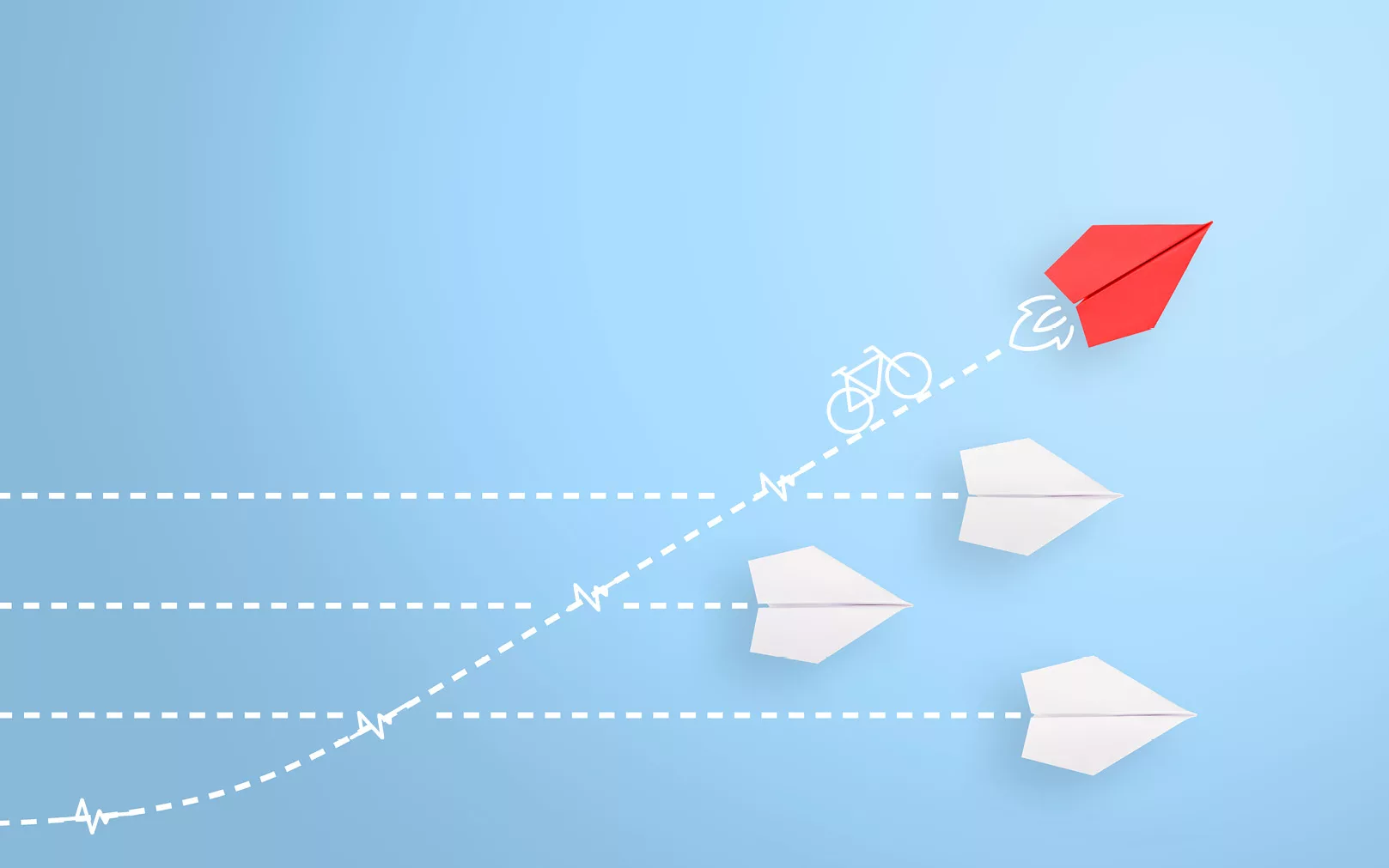Si la réadaptation cardiaque est reconnue comme une thérapie à part entière, au même titre que les traitements médicamenteux ou chirurgicaux, elle reste insuffisamment prescrite et accessible. Pourtant, ses bénéfices sont prouvés : baisse de la mortalité et des réhospitalisations, amélioration de la qualité de vie et des capacités fonctionnelles. Loin de n’être qu’un protocole médico-technique, elle est aujourd’hui considérée comme un enjeu de santé publique. Les évolutions légales et les recommandations les plus récentes en France dessinent un horizon plus structuré, basé sur l’accessibilité et sur la dimension humaine. Le point sur les changements de ces derniers mois.
1. Redessiner l’orientation : la HAS publie ses nouvelles fiches « points clés » (octobre 2024)
Le 17 octobre 2024, le Collège de la Haute Autorité de Santé (HAS) a validé une série de fiches « points clés ». Un solide argumentaire méthodologique les agrémente. Ces fiches pratiques sont destinées à guider les professionnels dans l’orientation des patients vers une réadaptation cardiaque ou vasculaire, qu’ils soient en phase post‑aiguë ou chronique.
Avec l’appui de notes de cadrage, de synthèses bibliographiques et d’avis d’experts, ces outils intègrent les algorithmes décisionnels, désormais incontournables. Ils permettent de repérer les patients les plus susceptibles de bénéficier d’un accompagnement adapté. Ainsi, les malades sont orientés efficacement vers les structures les plus pertinentes.
Pour ce faire, l’HAS a adopté cinq textes qui détaillent de manière pratique le protocole à adopter dans ces cas :
- fiche points-clés « Critères d’orientation d’un patient avec claudication intermittente (AOMI) vers la réadaptation vasculaire » ;
- fiche points-clés « Critères d’orientation d’un patient vers la réadaptation cardiaque » ;
- fiche points-clés « Critères d’orientation d’un patient avec lymphœdème secondaire vers la réadaptation vasculaire » ;
- fiche points-clés « Critères d’orientation d’un patient avec maladie veineuse chronique vers la réadaptation vasculaire » ;
- argumentaire méthodologique « Critères d’orientation en réadaptation cardiaque et vasculaire ».
2. SMR (anciennement SSR) spécialisés : un cadre renforcé et des compétences élargies
Le décret n° 2022‑24 du 11 janvier 2022 (entrée en vigueur le 1er juin 2023) fixe un nouveau cadre. Les SSR (soins de suite et réadaptation) deviennent des SMR (soins médicaux et de réadaptation), avec spécialisations, dont la mention « cardio-vasculaire ».
De fait, ces structures SMR doivent aujourd’hui recevoir une autorisation délivrée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour 7 ans (au lieu de 5 ans auparavant), avec une mise en conformité d’un an obligatoire. Cela garantit ainsi une prise en charge conforme aux standards.
Ainsi le centre doit justifier d’un équipement et d’une équipe pluridisciplinaire formalisés.
- Les équipes pluridisciplinaires doivent impérativement inclure : un cardiologue présent sur site, des infirmiers, un assistant social, un kinésithérapeute, un diététicien, un psychologue, la possibilité d’y adjoindre médecin MPR (médecine physique et de réadaptation), un ergothérapeute ou un enseignant en activité physique adaptée selon les besoins, et un médecin coordonnateur, formé ou expérimenté en cardiologie ou en réadaptation cardiovasculaire, qui assure la continuité des soins.
- Le centre doit justifier de locaux adaptés à sa spécialisation. Cela inclut : une salle de réadaptation adaptée, une salle de convivialité, des secteurs d’hospitalisation avec lits et un chariot d’urgence accessible
- Au niveau matériel lié à la spécificité « cardio-vasculaire » : une solution de monitorage (ECG, FC, saturation) par télémétrie, une salle d’urgence équipée pour la réanimation, un chariot d’urgence, un plateau d’effort (vélo, tapis), les fluides médicaux pour salle d’effort/rééducation, une épreuve d’effort cardiorespiratoire.
3. Phase II : la réadaptation au cœur de la prévention secondaire
Suite à un épisode aigu, il est préconisé de mettre en place la phase II de réadaptation cardiaque. Cette dernière bénéficie aujourd’hui d’une recommandation de niveau IA (classe I, niveau de preuve A), confirmée par les sociétés savantes. Elle est ainsi reconnue comme une thérapeutique à part entière. Elle est d’ailleurs scientifiquement soutenue : une réduction de la mortalité totale de 26 % et des réhospitalisations cardio-vasculaire à hauteur de 18 % ont été observées. D’autres bénéfices majeurs sont également mis en évidence :
- Amélioration significative de la qualité de vie et de la capacité fonctionnelle (VO₂ max, tolérance à l’effort) ;
- Réduction des symptômes dépressifs souvent associés aux événements cardiovasculaires ;
- Impact positif sur l’observance thérapeutique, notamment concernant les traitements de fond (statines, bêtabloquants, IEC/ARA2, anti-agrégants).
Un véritable levier de santé publique, encore trop peu accessible : malgré son efficacité, cette phase II demeure sous-utilisée dans les faits. Seulement 25 à 30 % des patients coronariens en bénéficient en France. Les taux sont encore plus faibles chez les femmes et les patients âgés. Les disparités régionales et territoriales restent importantes avec un déficit de structures dans certaines zones.
4. Téléréadaptation : l’essor de dispositifs innovants pour briser les distances
Afin d’améliorer l’accès à cette phase cruciale, plusieurs leviers sont en cours de déploiement. On observe l’émergence de la diversification des modèles de prise en charge :
- Structures légères ambulatoires, téléréadaptation, programmes hybrides ;
- Développement des parcours coordonnés ville-hôpital, intégrant médecins traitants et réseaux de soins cardiovasculaires.
En octobre 2024, la HAS a intégré la téléréadaptation et les modèles hybrides (présentiel + distanciel) dans ses fiches d’orientation. Le médecin oriente un patient vers ce type de prise en charge, dès lors qu’il ne présente pas de haut risque de complications. Il bénéficie ainsi :
- D’un plateau technique virtuel, permettant de réaliser à domicile des séances d’activité physique encadrées à distance ;
- D’un suivi médical sécurisé, grâce au monitorage (ECG, fréquence cardiaque, saturométrie) transmis par objets connectés ;
- De programmes éducatifs en ligne, centrés sur la gestion des facteurs de risque (hygiène de vie, observance thérapeutique, alimentation) ;
- D’un accompagnement psychologique via téléconsultations ou ateliers collectifs distants.
Par ailleurs, une expérimentation menée en 2023 présente des résultats positifs :
- Observance supérieure aux programmes classiques dans certains cas (car moins de contraintes de déplacement) ;
- Amélioration équivalente de la capacité fonctionnelle (VO₂ max, distance au test de marche de 6 minutes) ;
- Bonne acceptabilité par les patients et les soignants, à condition d’un accompagnement technique initial.
5. Recommandations spécifiques à l’insuffisance cardiaque (SFC, 2024)
La réadaptation cardiaque de l’IC (Insuffisance Cardiaque) ne peut pas se calquer entièrement sur celle des coronariens stables, car :
- Les patients IC présentent souvent une tolérance à l’effort très limitée, avec risque de décompensation.
- Ils ont des comorbidités fréquentes (diabète, BPCO, obésité, insuffisance rénale) qui complexifient la prise en charge.
- Leur profil est plus hétérogène (IC à FE réduite, préservée, modérément altérée ; patients jeunes vs très âgés ; fragiles ou non).
- L’entraînement physique doit être adapté finement (type, intensité, fréquence), d’où l’importance de la prescription selon le principe FITT.
Pourtant, moins de 10–15 % des patients IC accèdent à une thérapie de réadaptation. Pour améliorer leur prise en charge, la Société Française de cardiologie (SFC) a édité ses recommandations en septembre 2024. Ainsi, elle y détaille les profils de patients concernés, le bon moment pour initier la réadaptation, l’usage de la méthode FITT, ainsi que l’ouverture aux structures libérales légères (tels que préconisés par l’HAS).
a) Les patients insuffisants cardiaques, mais avec des nuances selon le profil clinique
- Insuffisance cardiaque à fraction d’éjection réduite (HFrEF, FE ≤ 40 %) : indication systématique, quel que soit le stade clinique (NYHA II à IV stabilisés).
- Insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée (HFpEF, FE ≥ 50 %) : bénéfice démontré sur la tolérance à l’effort et la qualité de vie, réadaptation conseillée.
- Patients âgés et fragiles : inclusion possible, avec adaptation individualisée des programmes.
- Comorbidités (diabète, BPCO, obésité, coronaropathie associée) : indication renforcée, la prise en charge multidisciplinaire permettant d’agir simultanément sur plusieurs facteurs de risque.
b) Le moment optimal pour initier la réadaptation
- Après la phase aiguë stabilisée : la réadaptation doit débuter rapidement après une hospitalisation pour décompensation, une chirurgie cardiaque, ou un épisode coronarien.
- Fenêtre optimale : dans les 4 à 6 semaines suivant la sortie d’hospitalisation, une fois la stabilisation clinique et thérapeutique assurée.
- Suivi longitudinal : la réadaptation n’est pas un épisode ponctuel mais doit s’intégrer dans le suivi chronique, avec des réévaluations régulières et des phases de réentraînement possibles en cas de rechute ou d’aggravation.
c) La SFC insiste sur l’usage du principe FITT (Fréquence, Intensité, Type, Temps) comme cadre systématique pour prescrire l’entraînement physique
- Fréquence : idéalement 3 à 5 séances/semaine, incluant au moins 2 séances supervisées.
- Intensité : adaptée à chaque patient, souvent 40–70 % de la VO₂ pic ou 60–80 % de la fréquence cardiaque maximale atteinte à l’épreuve d’effort ; recours à l’échelle de Borg pour ajuster la perception de l’effort.
- Type : combinaison d’exercices aérobiques (vélo, tapis de marche, natation douce) et renforcement musculaire (poids légers, résistance élastique).
- Temps : séances de 30 à 60 minutes, progressives, avec phases d’échauffement et de récupération.
- L’objectif est de maximiser la capacité fonctionnelle tout en limitant les risques de décompensation.